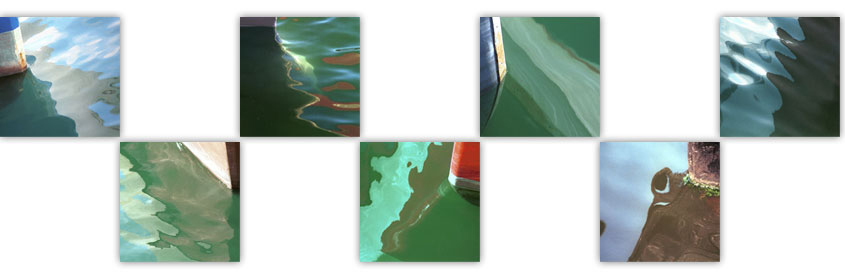Je n’essaierai pas de maquiller en enquête « scientifique » ce qui n’est guère qu’une question – dont je n’ai pas la réponse. Mon titre pourrait se paraphraser ainsi : y a-t-il un rapport entre le renouveau actuel des études rhétoriques, sous une forme principalement historique (constitution d’une histoire de l’art rhétorique, et retour de doctrines et de textes émanant pour la plupart d’un passé posé comme antérieur à la notion moderne de l’art littéraire), y a-t-il un rapport entre ce renouveau, ou ce retour, et la manière dont nous concevons aujourd’hui la littérature ? (Je parlerai surtout, à une escapade près, de situations observables en France depuis environ trois décennies). Nous assistons en effet, notamment pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sinon à une substitution pure et simple, du moins à une réécriture progressive (le phénomène n’a rien de foudroyant) de l’histoire littéraire par une histoire des pratiques rhétoriques, agissant seule ou de concert avec d’autres disciplines dont je ne parlerai pas ici (en particulier l’histoire du livre). S’agit-il d’une évolution purement académique, ou de l’installation d’une forme renouvelée de « rhétorique » dans ce que nous entendons par « littérature » ? Les temps dits classiques, l’Ancien Régime serviraient-ils, sous le masque de l’érudition spécialisée, d’avant-garde paradoxale à une nouvelle révolution ? Si l’histoire littéraire, telle qu’elle s’est imposée en France à la fin du XIXe siècle, a constitué son objet sur le modèle que lui proposait l’esthétique romantique, en considérant la « littérature », écrivait Marc Fumaroli dans L’Âge de l’éloquence (Droz, 1980), comme un « secteur à part de l’ensemble de la culture », dans quelle mesure peut-on associer, inversement, la faveur grandissante dont jouissent aujourd’hui la rhétorique et son histoire à l’essor d’une conception moins autonome du littéraire ?
Ce chiasme hypothétique a évidemment quelque chose d’artificiel. Il faut d’abord rappeler que les ruptures historiques auxquelles je viens de faire allusion sont en partie, sinon des leurres, du moins les moments mythifiés d’un récit héroïque que nous (Français) nous racontons, ce qui ne l’empêche pas d’être partiellement vérifiable (bel exemple d’une construction rhétorique, justement). Ainsi le règne de la « Terreur » diagnostiqué par Jean Paulhan dans Les Fleurs de Tarbes (mépris de la rhétorique considérée comme une culture du « lieu commun » au sens moderne et dévoyé du terme ; hypertrophie du langage par le désir qu’a chaque écrivain de trouver le « sien », obsession de l’originalité qui prend le pas sur tous les autres enjeux de la création littéraire) n’empêche pas la littérature romantique d’être massivement oratoire (Paulhan est le premier à comprendre que la Terreur est aussi une rhétorique, d’autant plus efficace qu’elle se nie elle-même), tout en contenant les germes d’un oubli institutionnel de la rhétorique comme telle et de ses conventions, qui sera (provisoirement) consommé, en France, par la réforme scolaire de la fin du XIXe siècle. De même, lorsque la poétique structurale prétend rompre avec l’histoire littéraire lansonienne, elle annonce en fait (mais elle ne le sait pas) le retour de cette même rhétorique, qui en prenant conscience d’être devenue « restreinte » (pour reprendre le mot fameux de Gérard Genette ; cf. Figures III, Seuil, 1972) s’efforce aussitôt de ne plus l’être ; à l’inverse, lorsque l’histoire de la rhétorique rompt avec la poétique structurale, elle tend à considérer celle-ci comme la manifestation extrême d’une idéologie littéraire dont l’histoire de la littérature relève également – qu’on en fasse l’histoire ou la théorie, c’est toujours de « littérarité » qu’il s’agit, hypostase dont il conviendrait maintenant de se débarrasser. Mais l’on peut aussi, et non moins justement, considérer l’histoire de la rhétorique comme un retour et une revanche de l’histoire littéraire contre tous les formalismes ; et ainsi de suite.
D’autre part et surtout, si l’on peut admettre que l’histoire littéraire, rompant avec la rhétorique des collèges, est sortie tout armée, bien qu’avec quelques décennies de retard, de la tonitruante révolution romantique et de son « sacre de l’écrivain » (pour reprendre l’expression non moins célèbre de Paul Bénichou), le scénario contraire, par quoi l’histoire de la rhétorique servirait de symptôme, sinon de cause efficiente, à une nouvelle transformation de la conscience littéraire, semble moins évident à nos yeux. Si révolution rhétorique il y a dans la culture, le moins qu’on puisse dire est qu’elle est confuse ; et dans la littérature, qu’elle est discrète. Mais la question mérite d’être maintenue : si par l’histoire littéraire « la Littérature [a] voulu projeter sur le passé une autonomie tardivement acquise » (je cite encore Fumaroli), que signifie la tentative actuelle de mettre fin à une telle projection ? S’agit-il seulement du passé, ou aussi du présent ?
S’agit-il seulement (Fumaroli toujours, à propos de la stylistique historique de Morris Croll) de « surmont[er] le dilemme littérature-rhétorique, sans doute fécond pour comprendre les auteurs modernes qui en ont vécu ou vivent de lui, mais qui, reporté sur le passé, stérilise la perception historique des styles », autrement dit de mettre fin, pour ce qui concerne ledit « passé », à l’anachronisme congénital de l’histoire littéraire ? Comme l’écrit de son côté Antoine Compagnon, retraçant le combat de Brunetière contre la suppression brutale de l’enseignement rhétorique dans la France de 1890, « Ce n’est pas seulement l’avenir de la littérature que l’extinction de la culture rhétorique modifie, mais aussi le passé, car sans cette culture nous ne sommes plus en mesure de comprendre dans ses propres termes la littérature française jusqu’au XIXe siècle » (« La rhétorique à la fin du XIXe siècle », in Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, PUF, 1999) ; « C’est que notre littérature classique », dit Brunetière cité par Compagnon, « – et je ne dis pas seulement la prose, je dis aussi la poésie – est essentiellement oratoire ». S’agit-il, dès lors, d’imposer un clivage entre la manière dont nous nous occupons de la littérature moderne, anti-rhétorique de naissance, et celle dont il faudrait s’occuper des littératures plus anciennes, rhétoriques par définition ? Ou s’agit-il, à terme, d’effacer ce clivage, mais cette fois au profit d’une approche globalement rhétorique des œuvres et du phénomène littéraire, littérature moderne comprise, son anti-rhétoricité n’étant qu’un moment dialectique, sa fameuse « Terreur » un leurre à dépasser ?
Pour le dire en termes plus terre-à-terre : en tant que spécialiste de la Renaissance, je ne me considère pas comme un dévot des études rhétoriques, mais j’en suis désormais suffisamment imprégné, tant par intérêt personnel que par l’évolution même de mon domaine de recherche, pour trouver normal de suggérer, en compagnie de mon collègue dix-septiémiste, à nos autres collègues d’ajouter un peu de Cicéron et de Quintilien à la liste de « théorie littéraire » que doivent assimiler nos étudiants de maîtrise et de doctorat. Certains de nos collègues modernistes sont plutôt chagrinés par cette proposition, qui leur paraît de nature à transformer notre programme de « théorie » en programme d’« histoire de la théorie », ce qui n’est pas la même chose. Peut-être ont-ils raison, et notre initiative revêt-elle un caractère, en effet, historique et documentaire, la « théorie » continuant pour sa part de gouverner la manière actuelle (ou les manières actuelles) d’interpréter la littérature en général. Peut-être ont-ils tort, et la même initiative signale-t-elle en fait que l’on peut désormais se servir de Quintilien pour mener à bien cette tâche, autrement dit que la théorie oratoire la plus classique est en train de retrouver non seulement droit de cité, mais une valeur opératoire pour aborder n’importe quel texte, ce qui (après tout) est un privilège reconnu, même par les poéticiens purs et durs des années 60, à la Poétique d’Aristote.
Peut-être les deux camps ont-ils raison : prenons Quintilien pour lire Montaigne et Bossuet, mais gardons Jakobson pour lire Baudelaire, ou Derrida pour lire Ponge. Cette solution mi-chèvre mi-chou, à supposer même qu’elle puisse s’entendre sur une frontière, a quelque chose de déprimant et de chimérique ; elle pose manifestement plus de problèmes qu’elle n’en résout, mais je me demande parfois si nous ne sommes pas en train de dériver, à l’aveuglette, vers une chimère de ce genre, sinon vers un mur de Berlin des études littéraires. Si l’on se souvient que les diverses poétiques « théoriques » dérivées du structuralisme ou du poststructuralisme (qui ont leurs propres conflits) se veulent capables de lire Montaigne ou Racine aussi bien que Baudelaire ou Ponge, il est clair qu’un recours préférentiel à la rhétorique historique pour parler des auteurs de « l’âge de l’éloquence » implique une diminution radicale des pouvoirs de ces poétiques, un rabaissement des ambitions a-historiques ou trans-historiques qui ont pu être les leurs. Une « théorie de la littérature » qui renoncerait à comprendre les écrivains antérieurs au romantisme, par exemple, avouerait par là qu’elle n’est plus une théorie – mais une simple description, contingente et datée ; ce que l’histoire de la rhétorique lui suggère justement qu’elle est.
À l’inverse, on pourrait dire d’un savoir rhétorique retrouvé qui se contenterait de rester confiné dans la description historique des œuvres qu’il n’a de rhétorique que le nom. Si l’on admet qu’une conception « oratoire » du texte, ou plutôt du discours, privilégie son « effet », la manière dont il « touche » son lecteur et le « persuade » de quelque chose, la description d’un tel effet au passé (voici par exemple les « lieux » de l’invention par lesquels Corneille ou Racine touchaient leur public : pour les comprendre, prenez Cicéron, livre I du De inventione, lieux de l’indignation et de la pitié) débouche sur un problème. Les « lieux » dont se servaient Corneille et Racine servaient à l’écriture et à la lecture ; ils servaient en fait à la « culture », et intervenaient dans la conception même que l’époque se faisait, par exemple, de la pitié ou de la colère. Les travaux pionniers de Francis Goyet notamment (voir Le Sublime du « lieu commun », Champion, 1996 ; et « Les “lieux” de la pitié dans Athalie », in Styles, genres, auteurs, n° 3, PUPS, 2003) nous montrent combien nous avions oublié ces « lieux » qui régnaient sur la production et la réception des œuvres. Non que nous ne soyons pas touchés par le spectacle de quelqu’un qui tombe « dans le malheur contre toute attente » (6e lieu de la pitié selon Cicéron). Mais nous n’aimons pas penser que l’on puisse codifier ce malheur, l’inscrire dans une liste raisonnée, donc exploitable, de situations pitoyables. Pour nous, c’est le réflexe d’un tabloid, non le dessein d’un grand écrivain. Dans une culture rhétorique, un tel lieu touche d’autant plus qu’il est reconnu comme tel, ou associé du moins à une famille de cas similaires.
D’où une série de questions. Lorsque nous essayons de réapprendre les « lieux », comme Goyet et plusieurs autres nous engagent à le faire, s’agit-il de clés pour lire Corneille et Racine, ou de critères dont nous pourrions faire usage, non seulement pour lire quelques grands textes, mais pour écrire, pour discourir, pour sentir et penser ? S’il s’agit d’instruments herméneutiques, au sens où la compréhension du concept de « conjointure » est utile à la lecture de Chrétien de Troyes, que faisons-nous de leur portée proprement persuasive, de leur aptitude à nous convaincre et à nous toucher ? Si nous nous efforçons d’en être touchés et convaincus, de laisser à nouveau les « lieux » résonner en nous, quel est le sens d’une telle volonté de sensibilité ? Considérée du point de vue de l’histoire de la rhétorique, notre démarche semble gouvernée par le souci d’exactitude, de fidélité aux œuvres, qui prend ici une dimension hallucinatoire : nous tentons d’être atteints « comme » l’étaient les contemporains de Corneille. Le vieux problème de l’histoire littéraire – le rapport de la lecture présente à l’œuvre ancienne, l’effort d’ajustement que représente l’accès à l’œuvre ancienne, l’existence de limites à cet ajustement – se trouve ici radicalisé. Ou bien les « lieux » et autres catégories rhétoriques sont de l’« information » contextuelle, éléments de sens contribuant à notre maîtrise du texte. Ou bien ils agissent, et c’est le texte qui, à certains égards, nous maîtrise. Mais s’ils agissent, cela suppose-t-il que nous ayons seulement fait l’effort nécessaire pour bien recevoir Corneille, par une variante hyperbolique du souci documentaire, ou que nous-mêmes soyons de nouveau gouvernés par les lieux ? Une culture rhétorique ne se contenterait pas du premier scénario ; elle s’efforcerait de se généraliser – non pas, à la manière de la théorie littéraire, en tant que démarche « scientifique » de lecture, de critique, d’interprétation, mais comme un art universel du discours.
Une conséquence en serait d’ailleurs que la fidélité absolue à Corneille, l’effort de reconstitution historique de l’effet, perdrait une part de son urgence. Une culture vraiment rhétorique postule l’aptitude du pouvoir persuasif – au moins dans certaines œuvres d’élite, c’est même là ce qui les distingue – à transcender son époque, en se transformant certes d’un contexte de réception à l’autre, mais de manière limitée : car une telle culture postule d’abord, plus généralement, sa propre intégrité trans-historique. Au-delà des différences, qui peuvent être considérables, les œuvres se laissent saisir d’un même regard normatif, disposer sur une échelle de valeurs ; faute de quoi ce qu’on entend sous le nom de « rhétorique » n’est qu’un répertoire d’effets caducs, reconstitués pour l’intérêt de la reconstitution. Si la rhétorique « classique » était vraiment vivante, l’érudition historique serait un souci important mais accessoire, au lieu de la première exigence du chercheur. Dès lors que l’érudition cherche non seulement à nous renseigner sur, mais à faire revivre la persuasion, elle se trouve prise dans un dilemme, s’obligeant à donner toujours plus de détails, mais pour suggérer, voire pour relancer ce qui devrait être une force qui va – un art qui touche par sa technique. L’histoire de la rhétorique, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, peut encore se croire positiviste, mais ce positivisme cherche, en dernière analyse, à s’abolir lui-même.
Ou bien, donc, l’histoire des pratiques et des modèles rhétoriques accepte de n’être que de l’histoire ; ou bien elle cherche à inaugurer ou à rejoindre une véritable rhétorique, c’est-à-dire un « système » compréhensif, capable d’intégrer aussi bien les œuvres qui se voulaient, en leur temps, tributaires d’une culture oratoire, que celles qui se sont crues étrangères à cette même culture. De la solution mi-chèvre mi-chou, qui correspond à ce moment pragmatique et sans doute provisoire de la vie académique où certains spécialistes de la littérature consultent Cicéron tandis que d’autres continuent de lire Genette ou Paul de Man, on peut donc dire qu’elle représente aussi bien la négation de la « théorie littéraire » que celle de la « rhétorique » comme telle, en ce que l’une et l’autre ont vocation à tout expliquer, ou bien à n’être pas ; et sans doute ce moment boiteux ne peut-il pas durer.
S’il devait durer, nous assisterions à l’éclatement de la littérature en domaines séparés relevant non seulement de méthodes, mais de présupposés distincts. C’est peut-être ce qui est en train de se produire : j’ai rencontré des « modernistes » qui disent ne plus comprendre ce dont parlent leurs collègues seiziémistes ou dix-septiémistes, et se sentent rejetés par leurs torrents de moins en moins contenus d’érudition classique. Ils ont l’impression qu’on n’a plus le droit de lire un vers de Racine sans être capable de citer non seulement l’Institution oratoire dans le texte, mais les milliers de pages qui l’ont commentée et exploitée au cours du temps. On voit certes mal au nom de quoi un spécialiste de Duras ou de Césaire se coltinerait les pages en question ; le désir de rester à portée de conversation de son collègue racinien n’est sans doute pas un motif suffisant.
Le fait est que le mouvement de redécouverte, d’ailleurs initié – c’est là une des ironies dont cette histoire fourmille – par la poétique structurale (que l’on songe à ses études, chez Genette ou Michel Charles (Rhétorique de la lecture, 1977), de Fontanier, de Du Marsais, du Père Lamy ; catalogues de figures, certes, mais aussi noms d’auteurs exhumés), ce mouvement s’est précipité et démultiplié. Nous sommes maintenant en présence d’un effet de corpus autant et plus que de doctrine : un corpus gigantesque, qui fait bélier, et bientôt irruption, dans une littérature déjà portée à se croire assiégée. C’est James Murphy commandant aux spécialistes de la Renaissance de lire « One Thousand Neglected Authors » dont nous ne savons même plus les noms ; c’est Marc Fumaroli complétant son monumental Âge de l’éloquence par une bibliographie de travail qui fournit « quelques points de repère » pour la recherche future, et ne compte pas moins de 1722 entrées.
Nous redécouvrons ainsi, non pas des poètes maudits, quelques archanges oubliés, mais des milliers de professeurs, prédicateurs, politiciens ou avocats. Autant de professionnels du discours qui remettent en question, par leur simple existence, ce qu’il est convenu d’appeler l’« autonomie » de la littérature – au moins dans la tête de ceux qui s’attachent à les exhumer. Prenons un domaine devenu central, celui de l’éloquence de l’éloge, le discours épidictique : c’est Laurent Pernot (La Rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, Études Augustiniennes, 1993) tirant de l’oubli plusieurs siècles de rhétorique impériale ; c’est Pierre Zoberman (Les Cérémonies de la parole, Champion, 1998) ramenant au jour l’éloquence d’apparat du Grand Siècle. Dans ces deux cas (parmi bien d’autres), des centaines de noms et de textes refont surface et leur entrée, sinon dans notre mémoire culturelle, du moins dans l’un de ses compartiments. Le cas de l’éloge est particulièrement significatif, comme l’a montré mon collègue Richard Lockwood (The Reader’s Figure, Droz, 1996), car si la théorie classique de l’art oratoire le considérait avec une certaine suspicion (en sa qualité de genre à la fois spectaculaire et libéré des contraintes les plus immédiates de la persuasion), la littérature, qui pour cette même raison devrait s’en sentir proche (voir la démonstration de Barbara Cassin, dans L’Effet sophistique (Gallimard, 1995), sur les accointances de la seconde sophistique et du roman), y reconnaît volontiers le pire de la rhétorique, celle qui n’a même pas l’excuse d’une tâche utile, et ne déploie ses figures que pour flatter son destinataire du moment.
Face à ce geste de redécouverte, à ce préalable « archéologique » de reconstitution d’une culture qui consiste, en l’occurrence, en millers de pages d’éloge (notamment d’éloge politique), on peut légitimement se demander : à quoi bon ? pour quoi faire ? Que faisons-nous d’une telle « culture », soudainement élargie ? Sommes-nous vraiment devenus capables de lire l’éloge de Rome d’Ælius Aristide comme nous relisons (parfois) L’Âne d’or d’Apulée, a fortiori Les Caves du Vatican ? Si nous en sommes capables, qu’est-ce cela veut dire ? D’où vient que nous soyons « capables », précisément, d’apprécier à nouveau un éloge du prince, le Panégyrique de Trajan ou ceux de Louis XIV ? Si « nous » n’en sommes pas capables, si cela reste, en fait, un objet pour spécialistes, cet objet relève-t-il d’une « culture », au sens où l’on parlait de culture littéraire, au sens où une culture rhétorique raisonnablement générale, en effet, existait autrefois ? Ou simplement d’un savoir appelé à demeurer spécialisé, étranger au goût des uns et des autres, au savoir plus commun, approximatif, pétri d’oubli au moins autant que de connaissances, bref : à la consommation actuelle, par un public réel, des œuvres littéraires du passé ?
Tout en se posant de telles questions, plus ou moins naïves et susceptibles de dérives polémiques, il convient de reconnaître un fait : le retour de la rhétorique auquel nous assistons ne fait à l’évidence que commencer. Nous sommes à peine sortis de la « rhétorique restreinte », de ce fétichisme des figures dont les derniers inventaires, centrés sur la seule elocutio, furent récupérés par la redéfinition moderne de la littérature autour du seul langage, autrement dit cooptés par une poétique anti-rhétorique, avant tout soucieuse d’isoler, de toutes les autres formes de discours, au titre d’un usage particulier des mots, la littérature – et singulièrement la poésie, concentré par excellence de cette « littérature en soi ». Lorsque la rhétorique, renaissant lentement à la conscience, a commencé de contester cette « restriction » dont les poétiques issues du romantisme tiraient le monde même du littéraire, elle a voulu remettre en jeu d’autres portions de son territoire – l’invention, la disposition –, d’autres fonctions du discours – le movere, le docere, le conciliare – supposant à divers degrés les formes de référence à, d’action sur, d’interaction avec, d’utilité dans le monde dont la littérature avait cherché pour sa part tantôt à s’exclure (non sans remords, ni limites, ni contradictions) et tantôt, au contraire, à s’assurer un énigmatique monopole.
L’un des aspects de cette immense entreprise consiste à relire les œuvres du passé selon les lois de cette rhétorique plus « complète » dont l’élision avait permis la constitution de l’histoire littéraire en discipline, et de canons littéraires anciens à l’usage de la modernité. On peut certes se contenter, à cet égard, de relire les parts anciennes du canon en injectant dans le commentaire un savoir rhétorique un peu moins fragmentaire ; ce qui revient à subordonner ce savoir aux présupposés esthétiques d’une modernité qui s’est constituée en les niant. Les « lieux » de la pitié pourraient ainsi s’intégrer, le plus discrètement possible, à l’art de l’explication de texte à la française. Une telle intégration n’en risque pas moins d’être ressentie, à terme, comme conflictuelle. Du point de vue de l’explication, qui pose la singularité du texte dans son langage, les lieux ont quelque chose de plat et de réducteur ; du point de vue des lieux, qui s’articulent à une théorie générale des émotions et des valeurs, l’explication a quelque chose de redondant et de gratuit. C’est pour sortir de ce faux miroir qu’une équipe de recherche comme celle que dirige Francis Goyet à l’université Grenoble 3 (Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution, ou RARE) a commencé par reconnaître qu’il y aurait un certain vice de méthode à s’attaquer aux grandes œuvres, « par hypothèse les plus difficiles », sans considérer en même temps, sinon préalablement, un vaste ensemble de pratiques professionnelles et de commentaires scolaires, seul moyen de comprendre en profondeur le fonctionnement d’un lieu de l’argumentation ou d’une figure de pensée. C’est en se redonnant cette « culture de base » que l’on se met en mesure d’évaluer la façon dont les hommes du XVIe siècle, par exemple, lisaient Virgile et Cicéron, pensaient Virgile et Cicéron, et pouvaient espérer les imiter.
Le même Goyet avait eu le courage, dans sa thèse monumentale sur le« lieu commun »,de pousser un peu la logique, nécessairement normative, d’une restauration du regard rhétorique, d’un regard interne à l’« empire rhétorique », c’est-à-dire à un monde où les discours, et très précisément les plus beaux des discours, sont sinon les plus « efficaces » au sens concret, du moins les plus impliqués, par des effets repérables et mesurables (effets de discours et non pas faits de sens justiciables d’une pure herméneutique), dans le destin historique de la cité. Goyet ne cache pas qu’il voudrait en finir avec ce qu’il appelle « la coupure entre la “littérature” et les choses sérieuses ». Certes « la littérature, Poésie ou Fiction », reconnaît-il, « ne saurait avoir d’influence directe sur les circonstances particulières, sur l’action finita ». Mais « elle change le monde en changeant, sans le dire, les Idées » : « non pas en les énonçant, mais en nous les faisant vivre de l’intérieur, passionnément, dans le registre du movere ». C’est en ce sens, au cœur de ce « faire vivre », conclut Le Sublime du « lieu commun », que « le mystère “poétique” fait un avec le mystère politique ».
Cette logique a sa souplesse : il ne s’agit nullement de réduire la poésie ni la fiction à des tâches de propagande, ni même de les assimiler à la grande éloquence politique ou judiciaire – bien qu’on refuse de les en « couper ». Mais cette logique a aussi ses rigueurs. Un Agrippa d’Aubigné en fait les frais, dont Les Tragiques si tardivement réhabilités manifestent pour Goyet une « coupure » entre « enseigner et émouvoir » : trop de dogmatisme d’un côté, trop de pathos de l’autre, et le tout fermé sur soi-même, ce qui rappelle la façon dont la littérature au sens restreint « s’autonomise, se coupe du monde extérieur, ne se soucie plus d’avoir du succès » : « Il ne reste plus qu’à admirer, en “littéraires” », conclut Goyet, ce pathos qui paraît plaqué à moins de l’apprécier pour lui-même. S’agissant peut-être du plus grand poème jamais redécouvert par l’histoire de la littérature française, la démonstration (provocation) est saisissante. Elle suggère qu’une culture rhétorique rendue à sa logique propre serait au moins capable de renvoyer un d’Aubigné sinon à son désert, du moins en bas de l’échelle : peu de poètes maudits dans l’empire du persuasif ; pas d’échec rhétorique converti, par magie rétrospective, en preuve de valeur littéraire.
Outre souplesse et rigueurs, cette logique a enfin son ordre : on a vu qu’elle détermine une méthode. Le fait même de poser un lien vital entre la rhétorique et les « grandes » œuvres (de quelque genre qu’elles relèvent) assigne à ces dernières un niveau de complexité qui exige, pour dépasser l’intuition qui les maintient dans la rhétorique, de reconstruire celle-ci à partir de la base des éléments techniques, de façon à montrer en quoi consiste l’intensification des procédures et fonctions persuasives dans les œuvres appelées non seulement à frapper leur époque, mais à lui survivre, à transporter jusqu’à nous leur « mystère ». D’où un programme de recherche qui nous renvoie aux écoles de rhétorique ; qui renvoie, littéralement, la littérature à l’école. Refus d’induire la rhétorique, à la faveur du commentaire, à partir et pour l’usage exclusif d’œuvres déjà sélectionnées par l’histoire littéraire ; projet de déduire les œuvres, et leur compréhension, d’une culture rhétorique reconstituée selon ses propres termes. Il s’agit bien de refonder, dans la description rétrospective même, la littérature comme rhétorique.
Observons au passage que l’institution universitaire est loin d’avoir encore les moyens d’un tel projet. En France par exemple, les programmes des différents concours et examens de lettres sont toujours « lansoniens » ; ils supposent qu’on se serve du savoir historique et rhétorique pour expliquer les œuvres, pour former leurs lecteurs – et non des œuvres pour illustrer et propager un savoir et un goût rhétoriques, c’est-à-dire pour former, sinon ce que nous appelons des « écrivains », du moins des praticiens du discours. La littérature règne encore, dans un cercle enchanté qui reste celui de l’histoire littéraire. Mais l’ambition des chercheurs de pointe est désormais affichée. Dans l’idéal, on suspendrait le cours de cette histoire, et on irait « au charbon » (image chère à Goyet) dans la bibliographie de Fumaroli, en évitant de spéculer sur Corneille ou Racine non seulement avant d’avoir maîtrisé Aristote, Hermogène, Cicéron ou Quintilien, mais avant d’avoir pratiqué, comme le fait l’équipe RARE, les manuels et traités qui émergent de nos bibliothèques.
Les historiens de la rhétorique sont ainsi entraînés, avec une rigueur dont leurs prédécesseurs n’avaient pu que rêver, dans une érudition de plus en plus profonde, de plus en plus technique, et foncièrement étrangère, sinon au corpus autrefois baptisé « littérature », du moins aux principes qui ont présidé à sa constitution. L’histoire littéraire se proposait de maintenir – et le cas échéant de re-créer – une forme de solidarité esthétique entre des textes admirables, plus ou moins anciens, et des lecteurs contemporains, tout en cherchant aussi à rendre compte, à donner conscience, de la distance qui les sépare. La contradiction, bien connue, consistait en ceci que les œuvres étaient observées, autant que faire se pouvait, dans l’histoire qui les avait « déterminées », comme documents de cette histoire, alors même que leur sélection mobilisait, explicitement ou implicitement, des critères plus ou moins étrangers à cette même histoire : un jugement a posteriori quant à l’aptitude de ces œuvres à entrer dans un « canon » trans-historique, sinon a-historique ; à scintiller pour l’éternité.
Il en résultait que l’historien de la littérature pouvait être amené, de place en place, à faire l’histoire d’une « littérature » qu’en conscience il méprisait, en lui reprochant de n’avoir pas (ou pas assez) eu conscience de son destin de... littérature, précisément. Je me permetttrai une référence rapide au cas qui éclaire le mieux, pour moi, cette perversion latente du regard : lorsque le grand érudit Henry Guy entreprit de faire en plusieurs volumes l’Histoire de la poésie française au XVIe siècle (Champion, 1910), il fut obligé de commencer, en toute rigueur chronologique, par les soi-disant « Grands Rhétoriqueurs », auxquels il consacra un premier tome remarquable tant par le scrupule exemplaire de la reconstitution bio-bibliographique que par l’incompréhension féroce, la sauvagerie militante du jugement esthétique lancé contre ces plumitifs infâmes, coupables d’avoir perdu tout sens de la « vraie » poésie en noyant sous les calembours les éphémères platitudes auxquelles les contraignait leur condition de chroniqueurs à gages. Guy ne ressuscitait les « rhétoriqueurs » que pour mieux les assassiner. J’oppose ici, comme Jekyll et Hyde, ces deux aspects de son discours, mais ils sont au contraire (comme Jekyll et Hyde) intimement liés : Guy n’est pas un historien exact et scrupuleux qu’entacherait et « daterait », à son corps défendant, un préjugé littéraire propre à son époque. Ce préjugé gouverne l’histoire exacte et scrupuleuse qu’il entreprend de raconter. Celle-ci n’a pas de sens en dehors de celui-là. Car il est l’historien de la poésie, qui narre l’émergence ou la ré-émergence de celle-ci comme telle : le scrupule historique est justifié par l’assomption de l’essence dont il raconte la « vie », l’épiphanie d’un genre autonome dont l’histoire, à une échelle plus vaste (celle d’une littérature nationale, par exemple), vérifie la vocation à se distinguer, à s’épurer toujours davantage. Le rhétoriqueur sera donc au poète ce que le pithécanthrope est à homo sapiens.
D’où ce spectacle d’un critique littéraire obligé de traiter en objet historique un morceau de « littérature » qui, à l’en croire, ne mérite pas ce nom ; d’un historien qui juge et condamne la période qu’il décrit, en l’examinant « de l’intérieur » mais sans chercher pour autant à dépasser un anachronisme dont dépend le sens de son entreprise. La carrière des rhétoriqueurs peut être racontée, la liste de leurs œuvres dressée, leur contenu résumé et raccordé à son contexte ; mais la conception qu’ils se faisaient de leur métier, l’esprit qui anime leurs œuvres est un objet que son « absurdité » fait tomber, sinon hors du récit, du moins hors de la « fin » qu’il se donne. Cette énorme lacune garantit la cohérence de la description. Il est clair qu’un historien de la littérature n’est pas tenu de réhabiliter tout ce qu’il touche – alors même que la question se pose, puisque l’histoire qu’il raconte est de part en part jugement de valeur ; et certes la discipline ne prive pas ses adeptes du frisson particulier que l’on trouve à inclure dans le canon ce que le canon commence par exclure. Mais la téléologie du propos n’en permet pas moins de faire justice aux précurseurs comme aux égarés, sans pour autant les sortir de leur rang.
Celui-ci est déterminé par les chefs-d’œuvre qui dessinent l’horizon, et qu’il s’agit d’expliquer par leur milieu tout en postulant qu’ils le transcendent. Cette contradiction, à la lettre intenable, est dans la pratique heureusement vécue : elle se résout en exercices de navette, entre l’œuvre et la carrière, entre l’écrivain et son siècle, entre majores et minores. Une sorte de stéréoscopie, d’ailleurs consciente d’elle-même et de la nature différente, sinon hétérogène, des objets qu’elle embrasse (ainsi, pour Raymond Picard, le récit de la carrière de Racine n’est pas la même chose qu’une explication de ses tragédies). D’où l’intérêt du voyage d’un Henry Guy en Grande Rhétorique : bien avant les polémiques des années 1960 entre historiens et poéticiens, cette flambée de violence révèle tout l’inconfort d’un érudit confronté par la logique de son récit à des objets réels qui révoltent sa sensibilité, qui menacent, par leur seule existence, l’objet idéal – « poésie » ou « littérature » – dont il est censé raconter l’histoire.
La même contradiction se retrouve sous d’autres formes : ainsi le canon de l’histoire littéraire retient-il de préférence, parmi les œuvres du passé, celles qui font le mieux écho au sentiment moderne d’une autonomie de la littérature ; mais aussi certaines de celles – Mémoires de Commynes, traités de Calvin, Pensées de Pascal ou oraisons de Bossuet – qui problématisent, sinon démentent, un tel sentiment, et ce alors même qu’il n’est pas question pour l’historien d’ignorer la vocation spécifique de telles œuvres, leur nature didactique ou « utilitaire », communicative et persuasive. Là encore la contradiction n’est pas dissimulée, mais négociée par divers moyens. Le plus efficace est l’application rétrospective de la « Terreur », c’est-à-dire l’hypertrophie individualisante du jugement stylistique, qui permet de distinguer, dans la foule de ceux qui ont écrit, les « vrais » écrivains de ceux qui ne le sont pas. Il vient toujours un moment où l’historien, anthologiste inévitable, lâche son couperet, et décide, en toute simplicité, ce qui est « littéraire », en vertu d’une définition, au moins virtuelle, de ce qu’est « le » littéraire. L’histoire littéraire la plus inclusive ne saurait, à l’instant du choix, faire l’économie d’une telle certitude. Elle exige le rituel d’une sorte de Jugement dernier, à la fois solennel et récurrent, absolu mais provisoire : car l’Enfer du non-littéraire est plutôt un Purgatoire, le Paradis du littéraire un Éden dont il n’est pas exclu qu’on soit un jour chassé.
Directement issue de la « contradiction » diagnostiquée par Jacques Rancière (voir entre autres La Parole muette, Hachette, 1998) dans la littérature romantique elle-même, l’histoire littéraire suppose en fait l’alliance, apparemment contre nature, de l’œuvre selon Flaubert, « livre sur rien », « sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style » (selon les termes d’une lettre fameuse à Louise Colet), et de l’œuvre selon Hippolyte Taine, « copie des mœurs environnantes », « signe d’un état d’esprit », « document » dont on peut extraire « la façon dont les hommes avaient senti et pensé il y a plusieurs siècles » (Histoire de la littérature anglaise, « Introduction » ; le rapprochement est de Rancière). Taine soutient qu’« un grand poème, un beau roman, les confessions d’un homme supérieur sont plus instructifs qu’un monceau d’historiens et d’histoires », et qu’il donnerait « cinquante volumes de chartes et cent volumes de pièces diplomatiques pour les mémoires de Cellini [...] ou les comédies d’Aristophane ». Il pense que les « œuvres littéraires sont instructives parce qu’elles sont belles », et que « si elles fournissent des documents, c’est qu’elles sont des monuments ». Le choix de la littérature comme objet historique privilégié fait corps avec la sélection esthétique de chefs-d’œuvre sensibles qui ne sont pas réductibles aux « documents » ordinaires, parce qu’ils en remplissent infiniment mieux la fonction. Dans le fil des analyses de Rancière, on remarque encore que la constitution de l’œuvre littéraire en « signe » d’une époque relève en fait d’une double monumentalisation : non seulement celle de l’œuvre, mais celle de l’époque que l’œuvre « représente ». Chez Flaubert, c’est le livre qui tient tout seul ; chez Taine, c’est la « civilisation » dont le livre émane : elle « fait corps », avec « ses parties qui se tiennent à la façon des parties d’un corps organique » ; elle fait « système », à l’intérieur de quoi tout se correspond impeccablement – jusqu’aux déficiences et aux « contrariétés » (car il arrive que des époques manquent leur littérature). L’histoire littéraire, comme exercice d’un jugement qui distingue infailliblement les grandes œuvres des moins grandes, et celles-ci des simples traces écrites du passé, forme la meilleure histoire possible – et doit révolutionner la science même de l’histoire. Les historiens d’archives et de documents non « monumentaux », retrouvant la forêt derrière l’arbre, n’ont pu que s’éloigner de cet idéal, et accuser en s’éloignant l’esthétisme d’une telle entreprise, c’est-à-dire un éloquent parti pris– regrettable de leur point de vue – dans la définition de son objet.
On peut définir l’histoire de la rhétorique, en tant que discipline académique appelée à envahir, voire à remplacer l’histoire littéraire (au moins dans les siècles qui précèdent le romantisme), comme une tentative de résoudre ou d’effacer les contradictions que je viens d’évoquer, en guérissant les historiens de la littérature de leur anachronisme esthétisant. On ne devrait, à la limite, prononcer de distinctions entre les œuvres, tant au plan de leur qualité qu’à celui de leur nature, que dans la mesure où ces distinctions sont autorisées, utilisées, vérifiées par l’époque décrite – et non plus par une décision rétrospective, relevant de ce que Taine appelait une « psychologie » (c’est-à-dire un « système » conjoint du contenu de l’esthétique et de sa place, nécessairement éminente, dans toute civilisation qui se respecte). Ainsi la description des rhétoriqueurs, par exemple, ne devrait-elle plus souffrir de lacune criante : il devient possible d’inscrire la haute conception qu’ils se font de leur tâche d’historiens et d’orateurs au cœur du récit de leur carrière comme de la lecture de leurs textes, et de s’en servir pour prendre une plus juste mesure des techniques exotiques (comme celle de la rime équivoque) qui attirent de préférence le regard moderne, soit que celui-ci s’en indigne, comme chez Guy, soit qu’il s’en enchante, comme chez Paul Éluard ou Paul Zumthor.
Une approche « rhétorique » des rhétoriqueurs a ainsi pour effet de réduire ce que j’ai appelé l’hypertrophie du jugement stylistique. Non que l’on doive maintenant ignorer ce qu’a d’extrême l’art verbal de ces auteurs ; mais il s’agit désormais d’évaluer cet art, cette elocutio spectaculaire, dans le cadre d’une rhétorique complète, c’est-à-dire de lui restituer non seulement son invention et sa disposition, mais la panoplie des « offices » que ces écrivains prétendaient remplir. Que leurs œuvres se développent à l’intersection du délibératif et de l’épidictique, comme à l’intersection du vers et de la prose (des première et seconde rhétoriques), ne présente plus d’obstacle préalable à une méthode qui n’a pas besoin de vérifier, de purifier à tout instant sa propre conception du littéraire ou du poétique. Il ne s’ensuit pas que les rapports et fonctions du discours (ceux du vers et de la prose, par exemple), deviennent faciles à comprendre ; au moins s’est-on posé la « bonne » question en se proposant de les comprendre ensemble, au lieu de jouer d’une dimension contre l’autre. À cette question, il est entendu que la réponse, quelle qu’elle soit, sera « historique », en ce sens qu’elle a pour objet la conception même que Molinet ou Lemaire et leurs commanditaires ou destinataires, dans leur contexte spécifique, se faisaient de ces rapports et fonctions pour écrire et pour lire leurs discours.
Qu’en est-il, cependant, de ce que nous disent ces rapports, à nous lecteurs d’aujourd’hui ? C’est la question même que l’histoire littéraire réglait d’avance, en assignant au texte du passé l’un quelconque de trois statuts : celui de chef-d’œuvre « pour aujourd’hui » – parce que pour l’éternité ; celui d’œuvre mineure, voire ratée, ou même aberrante, mais néanmoins intéressante, et utile, par contraste ou filiation, à la compréhension du chef-d’œuvre ; enfin celui de source « non littéraire », de « document » donc, mais de même utile à l’analyse et à l’appréciation du chef-d’œuvre, comme l’humus l’est à la croissance de l’arbre. Or la culture rhétorique aussi avait son palmarès. Et pour autant que l’historien de la rhétorique se sente appeler à juger (reste à savoir dans quelle mesure), il s’agira pour lui de juger à nouveaux frais, en commençant par essayer de comprendre le jugement de l’époque concernée sur l’œuvre – lequel n’est pas séparable, s’agissant de rhétorique, des effets de l’œuvre sur l’époque, qu’ils soient directs ou indirects, finis ou infinis. Nous avons vu que des gens comme Francis Goyet posent avec une intensité renouvelée cette question du jugement de valeur. L’on peut certes craindre que la rénovation ou restauration de ce jugement ne soit pas pour demain : le seul dépouillement de la masse des « neglected authors » repoussera sans doute de quelques décennies la remise des médailles. Nous avons vu qu’une phase « archéologique » semble incontournable, où il s’agisse moins de réhabiliter que d’exhumer : n’allons pas distinguer prématurément, suggèrent les chercheurs, entre les praticiens de genres de discours que nous comprenons mal. Il faut lire beaucoup d’éloges de l’époque impériale pour décider de la valeur d’un Ælius Aristide, au lieu de voir en lui le token, le simple représentant d’un genre discrédité. Le risque d’anachronisme ne s’efface pas pour autant ; mais c’est alors le risque de tout effort historique, qui porte un regard actuel sur l’inactuel en essayant de se purger de ce qu’il y a d’actuel dans sa curiosité, tout en proposant les résultats obtenus à cette même curiosité, qui ne saurait cesser d’être d’aujourd’hui.
Il n’empêche qu’une question, nous l’avons vu aussi, se pose sans attendre, au-delà ou en deçà de ce risque prévisible : les études rhétoriques ont-elles pour enjeu ultime de réveiller des techniques, des critères et des formes, de les rendre à leur puissance – ou simplement d’en refaire l’histoire ? La réponse varie selon les praticiens, qui ne sont pas unanimes à se vouloir historiens par hypothèse ; et selon les moments de leur pratique. Mais il est au moins concevable que s’efface toute différence pertinente entre l’objet de ce type d’analyse et n’importe quel objet historique, offert à l’intérêt d’un public (vaste ou restreint) en cela même qu’il n’est pas du « monde » de ce public, ou qu’il en participe à un tel degré d’éloignement qu’une connaissance directe doit être réputée impossible, et son illusion nécessairement suspecte – au mieux, un mythe à redresser : le « best seller » historique, si j’ose dire, étant typiquement celui qui exploite le mythe contre lui-même, rétablit la « vérité » à l’encontre d’une croyance ou d’une doxa perpétuellementtitillée par l’espoir d’être contredite. En s’attachant de préférence à des discours jugés jusqu’ici trop utilitaires ou trop référentiels pour être admis au temple de la littérature, l’histoire de la rhétorique participe ainsi du mouvement plus large de l’histoire et de l’archéologie contemporaines vers la vie quotidienne, jusqu’au substrat matériel (objets de toilette, de cuisine…) et au vécu subjectif (odeurs, saveurs…) de l’existence ordinaire. Les disciplines parallèles touchant à la chose écrite (comme l’histoire du livre, des milieux culturels, des carrières littéraires, de la production ou réception des œuvres en tant que faits sociaux), également en plein essor, s’inscrivent dans le même mouvement et contribuent à fondre, dans les fines descriptions qu’il permet, l’évaluation des pratiques persuasives et de leurs résultats.
Tout ceci consommerait, à terme, le sacrifice de la « littérature », en faisant de la dimension esthétique des œuvres un objet exclusivement historique ou, à l’inverse, de la connaissance historique le seul médium d’une perception esthétique des œuvres. L’historien de la rhétorique ainsi conçu partage au moins une prémisse avec Taine : c’est que les grandes œuvres sont potentiellement plus riches en information que d’autres « documents ». Mais là où Taine en concluait qu’elles doivent être considérées d’emblée comme le meilleur document possible, notre chercheur n’imagine plus de saisir leurs enjeux sans s’être fait une idée complète de « l’ordre du discours » en vigueur à l’époque concernée. C’est la différence entre une approche qui place en vis-à-vis, pour le bénéfice d’une interprétation « moderne », l’œuvre et le « monde » dont elle témoigne, et une approche qui réfléchit d’abord au mode d’action « ancien » de l’œuvre sur le monde en question. Du même coup, cependant, la question naguère prévenue par le jugement de valeur n’en finit plus de se poser à lui ; et le sacrifice pourrait bien s’en trouver compliqué, ou reporté.
Ainsi, que je comprenne enfin les rapports de l’inventio et de l’elocutio chez les rhétoriqueurs (à supposer que j’y parvienne) ne garantit pas que je trouve de tels rapports émouvants, ou tout simplement « beaux », au sens où Paul Zumthor (Le Masque et la lumière, 1978) trouvait belle l’« équivoque généralisée » qu’il détectait et célébrait chez ces auteurs. Mais supposons que ce soit le cas ; que l’enthousiasme de la découverte induise en moi un tremblement spécifique, et que je me prenne à contempler, du point où je me trouve, la lumière de l’éloge ou du conseil dispensés au prince, en telle circonstance oubliée, par George Chastelain ou Jean Molinet ; donc à partager, au moins en partie et pour un instant, ce qu’ils nommaient « Glorieuse Achevissance », sommet radieux de leur système – esthétique et rhétorique à la fois. Il ne s’ensuit certes pas que j’arrive à communiquer mon émotion à un véritable public (au-delà des collègues qui s’intéressent, de par le monde, au même objet, et ressentent la même ardeur). Le moyen le plus sûr serait encore le régime narratif de l’exotisme historique, qui aboutit à rendre désirables comme tels les objets du passé, et délectable l’eurêka de la reconstitution – qu’il s’agisse d’une assiette ou d’un parchemin, de la vie d’un paysan du XVe siècle ou de la mort du duc Charles. Mais que signifie, en moi-même, lecteur de textes devenus obscurs, la tentation d’un tel régime ? Dans quelle mesure mon émotion et ma contemplation, qui ne sont plus induites par la magie d’une décision a priori, le sont-elles par la réactualisation d’un effet persuasif auquel il n’est guère aisé de se soumettre, ni même de prétendre se soumettre, en l’occurrence, quand on n’est pas du « monde » que l’œuvre vise ? Peut-être ne s’agit-il, tout bien pesé, que de la portée « documentaire » de cette œuvre : de sa contribution à l’histoire du monde en question. En somme, n’est-ce pas le passé comme tel – ou plutôt le récit du passé qui m’excite ?
Excitation éminemment respectable, il va sans dire, sans laquelle il n’est pas d’histoire ni de mémoire qui tienne. La question reste pourtant de savoir ce qu’elle fait, non plus du sentiment esthétique dont l’anachronisme voulu de l’histoire littéraire s’était porté garant, mais de l’effet proprement rhétorique dont elle salue la reconstitution supposée. La difficulté centrale tient, répétons-le, à la tentative de reconstituer un effet du passé : cet effet (émotif) se trouve-t-il, du même coup, restauré ? Si oui, dans quelle mesure ? L’histoire de la rhétorique réactive-t-elle l’effet rhétorique, ou bien nous raconte-t-elle en quoi il consistait ? Y a-t-il, entre ces deux termes, une zone intermédiaire où ils se contaminent ? En admettant même que l’effet soit d’une certaine façon relancé, qu’est-ce donc que le recevoir aujourd’hui, hors culture, hors contexte ? N’est-ce pas la même chose que de l’esthétiser, quel que soit le scrupule de la reconstitution, de la réactivation ? La question reste de savoir si une fusion ou, au minimum, une juste et durable association est envisageable entre la compréhension historique d’une œuvre, sa perception « rhétorique » virtuelle, et sa perception « esthétique » actuelle, ou si l’un de ces termes finit toujours par prendre les autres en otage. Lorsque Fumaroli, dans L’Âge de l’éloquence, s’emporte contre l’habitude contemporaine de monter Corneille ou Racine dans le vocabulaire dramatique de Brecht ou d’Artaud, la logique de son raisonnement, pris au pied de la lettre, reviendrait à dire que l’homme de 1980, aussi fort que Pierre Ménard, l’auteur du Quichotte, peut arriver à entendre, à subir Corneille exactement comme l’homme de 1636 ; ce qui est une vue de l’esprit. Mais l’argument est polémique et stratégique : il s’agit de créer un scrupule dans la modernité, de la rendre un peu moins ardente à s’emparer des œuvres du passé pour en faire ce qu’elle veut. Il n’est que trop facile d’opposer à cette logique, qui court le risque de sauver la rhétorique – la dimension de l’effet et de l’action des œuvres – en la pétrifiant, la part irréductible d’anachronisme que comporte toute expérience esthétique, le « contexte » risquant toujours, quant à lui, de nous servir d’alibi, de n’être invoqué que pour nous permettre de mieux nous approprier l’œuvre, nous qui n’en sommes finalement comptables que devant nous-mêmes.
La question a son intérêt théorique ; mais elle a surtout un aspect pratique, qui est le plus important si l’on raisonne en termes de public ; de lecteurs actuels. Il n’est guère difficile d’imaginer ces lecteurs en consommateurs de synthèses historiques : on n’a pas besoin d’être initié au dépouillement d’archives pour apprécier les résultats d’un tel dépouillement dans une biographie de François Ier, une histoire de la Révolution, ou une chronique de la vie quotidienne dans un collège jésuite du XVIIe siècle. Il est moins facile de les imaginer en amateurs directs des discours, dont se délectent maintenant les spécialistes, qui furent produits ou consommés autour de ce roi, durant cette révolution, sur les bancs de ce collège.
Considéré dans son devenir, de façon aussi dynamique que possible, le problème que nous vivons se distribue, en somme, en différents cas de figure, contradictoires mais non pas, me semble-t-il, incompatibles, au moins pour un temps. Pour récapituler, sinon conclure, ces réflexions, j’en distinguerai au moins trois, sans me dissimuler ce que l’exercice a d’artificiel.
Le premier, dont je donnerai (pour tout simplifier) deux versions successives, consisterait à supposer que le public moderne reçoive à nouveau une éducation au moins analogue, par quelque biais, à celle du collège en question : soit un entraînement normatif, qui n’apprenne pas à lire sans apprendre à écrire, ni à écrire sans apprendre à persuader, ni à persuader sans se faire une idée précise de ce dont il convient de persuader, c’est-à-dire, en dernière analyse, des officia, des devoirs que confère l’appartenance à telle collectivité. Autrefois ce travail d’apprentissage était inséparable de la fréquentation des grandes œuvres – qu’il s’agisse de Virgile, de Cicéron, ou du Ronsard où l’on puisait, dès 1555, des exemples de rhétorique française. Mais si une rhétorique aujourd’hui « revenait », comme discipline d’écriture et de pensée (et non plus comme supplément d’âme ou recadrage historique de la lecture), il est probable qu’elle n’invoquerait plus que pour mémoire, non seulement l’héritage grec et latin, mais quelque héritage littéraire que ce soit. On y étudierait peut-être l’argumentation selon Perelman, mais peut-être seulement la médiologie selon Debray ou, dans le pire des cas, la publicité selon Séguéla : une néo-rhétorique vraiment « impériale » pourrait fort bien n’avoir avec son antique cousine qu’une ressemblance d’ordre mécanique ou fonctionnel, loin en tout cas de toute innutrition. Elle passerait à la rigueur par des méthodes formellement comparables ; mais pas nécessairement par des textes, et encore moins par ceux que personne ne lit plus « dans le texte » : qui dit nouvelle rhétorique ne dit pas nouvelle Renaissance. On peut ainsi envisager que la restauration d’une culture oratoire n’ait jamais lieu – sauf à servir, fantomatiquement, de caution à quelque chose de très différent : la dilution de toutes formes de discours, littérature comprise, dans la « communication » généralisée, qui ne connaît aucun « mystère » poétique ni politique, mais seulement l’évidence superlative du « spectacle » analysé par Guy Debord, avec son immédiat feed-back, réseau de réactions aussi prévisibles qu’éphémères, mesurables en parts de marché.
Cette version quelque peu apocalyptique de mon premier cas de figure (dictée sans doute par la frayeur – mauvaise conseillère – de voir disparaître tout intérêt pour la littérature) n’est pas la seule possible, et je me hâte d’en procurer une seconde, récemment rencontrée – ce n’est pas un hasard – dans un éditorial de Mary Louise Pratt, présidente en exercice de la Modern Language Association, publié par la MLA Newsletter de l’automne 2003. Voici un extrait de cette pièce, qui permettra de sortir un instant de la perspective « franco-française ». Elle s’intitule « The New Humanities » :
When a new branch of California State University was established at Monterey Bay eight years ago, the founding faculty had a mandate to establish a nonconventional array of departments. A small core of humanists joined to form an integrated humanities degree program with a mission to prepare students to be ethical, creative, and critical thinkers and doers in a culturally diverse society and an increasingly interconnected world. Without prescribing set disciplines, this core group was placed in charge of its own growth. Today the department includes an expert in philosophy, communication, and legal studies ; a United States cultural historian ; a journalism and media studies specialist ; an oral historian in Latina-Latino studies with a background in Spanish medieval literature ; a leader in the creative writing and social action movement ; a well-known Chicana poet with experience in law and business ; an expert in rhetoric, religious studies, and gender studies ; and half a dozen others with similar cross-disciplinary commitments.[1]
Je suis frappé de voir à quel point cette liste attache la littérature de passés lointains à celle du présent le plus militant, au sein d’une opération plus vaste qui est de rattacher la littérature, sans privilège particulier, à ce qui n’est pas, ou plutôt n’était pas elle, ou plutôt n’était plus elle, depuis un siècle ou deux : la philosophie, la religion, le droit, la politique d’une part, la communication d’autre part, le tout servant à former un « ethical thinker and doer » en qui il est facile de reconnaître une version moderne du vir bonus dicendi peritus de la rhétorique ancienne – à ceci près que ce « doer », que les « nouvelles Humanités » auront formé à agir, y compris mais pas seulement par la parole, a maintenant un peu moins de chances d’être un vir, un chevalierromain, et un peu plus d’être une juriste chicana : la latinitas change de sexe et de sens. Mais l’enjeu est bien d’inscrire ce que nous appelons encore la littérature dans un horizon culturel et social beaucoup plus large, en la mariant à d’autres disciplines pour mieux intervenir dans le monde qui rend cette opération nécessaire – en ce qu’il doit naviguer entre deux tentations complémentaires : celle de se fragmenter en un chaos d’identités qui ne communiquent plus entre elles ; celle de se dissoudre en un tropisme de communication qui n’ait plus rien à communiquer. En tant qu’expression des unes, en tant que structuration de l’autre, peut-être la littérature est-elle en train de disparaître en effet « comme telle », mais pour « renaître » aussitôt, à nouveau inséparable de ces disciplines éthiques et politiques dont elle s’était coupée pour usurper à elle seule, par métaphore, l’ensemble de leur prestige.
Il va de soi que ces deux versions du premier cas de figure, l’une négative et l’autre positive, sont aussi affaire d’appréciation, et qu’un « humaniste » féru de littérature risque à tout moment de voir dans le département de Monterey Bay un exemple achevé de la destruction, non de la promotion, des « Humanités », plongées dans une sorte de soupe dont n’émerge plus que l’exigence de « communiquer » accompagnée, pour faire bon poids, d’un certificat de conformité morale libéralement attribué aux groupes qui font du business entre eux. Il y a là matière à des empoignades idéologiques. Mais il faut surtout voir que l’ambiguïté est réelle, qu’elle n’est pas résolue : le département de Monterey Bay (dont j’ignore tout) et ses semblables me paraissent susceptibles, suivant ce qu’attend d’eux leur environnement, suivant ce qu’ils attendent d’eux-mêmes, suivant (surtout) la nature et le degré des rapports de force qui subsistent entre les disciplines qui prétendent ici se fédérer sinon fusionner, de vérifier l’un ou l’autre de ces deux scénarios – capables de faire disparaître la littérature comme de la faire renaître aux conditions que j’ai suggérées.
J’en viens au second cas de figure, que j’ai déjà largement évoqué : le triomphe – éventuel – de l’histoire. La faim toujours plus grande de connaissance historique devrait permettre de fournir au public la marchandise rhétorique au second degré, sous une forme rendue digeste par son absorption préalable dans un récit de « ce qui s’est passé », au même titre que toutes sortes d’autres informations (dont celles fournies par les disciplines historiques parallèles que j’ai mentionnées plus haut). De ce point de vue, et pour en revenir à cet exemple, on peut imaginer que la vie quotidienne des élèves de l’Ancien Régime nous devienne passionnante, et qu’elle s’illustre pour notre plaisir de quelques morceaux choisis, bonnes pages de manuels ou pensums de potaches, comme on cite ailleurs un rapport de police ou une page de comptabilité. De même, une histoire de l’Académie française pourra citer d’obscurs discours de réception qu’il ne viendrait à l’idée de personne, hors un petit cercle de spécialistes, de lire pour eux-mêmes. Il suffit en somme que les historiens de la rhétorique s’acceptent, sans arrière-pensée, historiens tout courts, comme leurs collègues qui s’occupent d’idées, de modes, de pratiques sociales, d’institutions. En prétendant faire lire des textes pour eux-mêmes et nous révéler le secret de leur durable beauté (ou de leur échec à l’atteindre), l’histoire de la littérature se condamnait à danser entre deux discours : le sien et celui qu’elle voulait servir. Si la littérature n’intéresse plus, son histoire n’a pas lieu d’être. L’histoire de la rhétorique pourrait contourner cet obstacle : il lui suffit de s’admettre histoire pure, et le problème d’un rapport personnel, qui ne soit pas surveillé par un récit, entre lecteurs et textes n’a plus besoin d’être posé. Il semble cependant qu’elle soit loin d’être unanime à vouloir d’un si simple destin, et que son rapport aux œuvres reste plus ambigu que celui qui s’observe, par exemple, dans l’histoire du livre ou l’histoire des milieux culturels, souvent mieux assurées de leur objet : le second cas de figure bifurque lui aussi.
Il suffit pour cela que l’approche rhétorique se risque à éveiller la vis, la force persuasive des textes, comme nous avons vu qu’elle a tendance à le faire ; et même si elle ne peut, faute d’une assise suffisante, y parvenir entièrement, ni faire tout à fait sienne cette force pour la transmettre sans déperdition, autre chose serait qu’elle se contente de la rendormir, ou de n’y reconnaître, comme ses consœurs plus « positives », que le jeu sans surprise de telle détermination objectivable (sociologique ou autre). Nombreux sont en fait les ouvrages critiques de ce (nouveau) type qui débordent d’un enthousiasme pour ainsi dire décalé, d’une sorte de prosélytisme paradoxal : leurs moments les mieux inspirés font admirer (mais à qui ?) dans les textes eux-mêmes un « système » fraîchement redécouvert, qui n’est plus le « nôtre » et ne le redevient pas ipso facto, mais dont la cohérence et l’énergie sont maintenant suffisamment perçues pour faire résonner, fût-ce brièvement, un enjeu plus large dans une sorte d’espace, de « lieu » intermédiaire, que nous serions tentés de rejoindre, quoique sa structure d’ensemble, sa stucture finale en tant que « culture » nous demeure mystérieuse. Ce n’est pas seulement, dans un tel scénario, le récit du passé qui m’excite, mais bien l’inventio de tel rhétoriqueur dont je distingue et subis un instant l’aura spécifique – bien qu’elle me reste, d’un autre point de vue et la plupart du temps, on ne peut plus étrangère. Malaise d’un côté, éclairs de l’autre.
Entre ces deux (ou quatre) premiers cas de figure, diverses combinaisons ou contaminations sont envisageables. Remarquons d’abord que l’histoire est un discours très susceptible de s’inscrire dans un programme de « New Humanities », comme le démontre l’équipe de Monterey Bay, avec son United States cultural historian (notons toutefois le cultural) et son oral historian (notons le oral). Mais l’assimilation n’est pas inévitable : d’autres historiens, ou d’autres types d’historiens, refuseront de soumettre leur art et son éthique de la vérité à une exigence « culturelle » et militante de formation des consciences, qui leur paraîtra insuffisamment désintéressée ; le vieil idéal de la magistra vitae sent aujourd’hui sa manipulation. Force est d’ailleurs de reconnaître, dans ce dernier scénario, que l’intérêt de la littérature et des « littéraires » cherchant à préserver, eux aussi, la spécificité de leur discours favori risque de se situer plutôt du côté de la « communication » que de celui d’une discipline qui recrute les œuvres à titre de documents et ne se soucie guère de les laisser « agir » toutes seules. Reste que l’histoire est aussi une rhétorique, et que le public actuel, inlassablement ému, semble-t-il, par le vécu qu’on lui raconte, en fait un usage que l’on pourrait qualifier de « littéraire » – mais relevant d’une littérature qui bannisse, autant que possible, la fiction. En parcourant les rayons de non-fiction des librairies (américaines, mais la situation n’est pas si différente en France), il est difficile d’échapper au sentiment que c’est d’abord l’histoire qui nous sert, en ce moment, de littérature, et d’abord le « document » (c’est-à-dire la mise en récit véridique et contrôlable du document proprement dit) qui nous émeut. Auquel cas le fait que certains de ces documents concernent la littérature d’un passé lointain (ou même récent) dédouble, pour ainsi dire, le plaisir de s’instruire – comme si nous attendions maintenant des grands écrivains et des grands textes que quelqu’un nous les raconte. Signe parmi d’autres, il me semble que la biographie littéraire ne s’est jamais mieux portée ; elle n’a de rivale que la biographie royale : au rebours de ce que je viens de suggérer, c’est peut-être au fil et au filtre de l’histoire que nous consommons le mieux, désormais, nos rois et nos poètes.
Il faut cependant rappeler (puisqu’il a été question d’« oral history ») qu’à l’extrémité – ou à l’extrême opposé – d’un tel filtrage ou recyclage narratif se rencontre aussi (quoique plus rarement), sur les rayons des mêmes librairies, un discours historico-esthétique radicalisé, poussé jusqu’au comble du paradoxe que j’évoquais il y a un instant – et qui met ou mettrait dans le même sac, avec leurs modes d’enregistrement et d’accumulation respectifs, les cultures établies de la littérature moderne et de la rhétorique ancienne. Ce dont nous parle ce discours, pour en faire sentir le manque et non plus pour donner l’illusion d’une présence, ce n’est pas d’œuvres que nous pourrions encore lire si l’envie nous en prenait, ou qui pourraient à nouveau nous toucher si nous nous en donnions les moyens ; mais de créations franchement inaccessibles, englouties en même temps que le monde qui leur donnait lieu, et dont l’écrit et la lecture qui en conservent la « tradition » ne livrent plus qu’un reflet mort. C’est dans de tels parages que s’aventurent Paul Zumthor (Introduction à la poésie orale, La Lettre et la voix, Seuil, 1983-1987) ou Florence Dupont (L’Invention de la littérature, La Découverte, 1994), pour évoquer une « littérature », médiévale ou antique, qui n’en était pas une (au sens où nous l’entendons), ni une rhétorique (au sens, non moins livresque, où nous essayons de l’entendre), mais une forme d’oralité en acte, que sa survie momifie (l’image est de Florence Dupont). C’est alors qu’un discours de savoir sur un effet disparu (qu’il soit ancien ou récent) nous invite moins à traquer un corpus perdu pour capter au moins une partie de son rayonnement qu’à en recréer, avec nos propres corps, une version nouvelle : et c’est peut-être ainsi (pure spéculation de ma part) que l’oral historian de Monterey Bay est passé(e) de l’Espagne médiévale aux Latina-Latino studies les plus contemporaines. Ce discours échappe aux difficultés qui nous occupent, mais en les rendant pour ainsi dire absolues ; et finit par sortir de lui-même pour faire entrevoir autre chose : l’effet de l’œuvre ancienne s’est si totalement enfui qu’il fait naître, sous la plume de spécialistes qui en ressentent – et cherchent à en faire ressentir – l’absence, le souci d’en accueillir, voire d’en éveiller un avatar entre les lignes de la culture d’aujourd’hui. De tels exemples passent pour des cas limites (bien qu’encore autorisés par une compétence on ne peut plus savante), mais leur leçon est sans doute plus vaste ; et ils suffisent en tout état de cause à montrer, au-delà du débat que j’examine ici, une crise plus générale, ébranlant à la fois tous nos rapports avec le fait, l’idée, le désir ou la mémoire de l’art.
Mais pour en terminer avec ledit débat : le troisième cas de figure contredira bien sûr, au moins en partie, les précédents. Les conceptions issues du romantisme, on l’aura compris, font de la résistance, à l’université comme ailleurs. À l’instar de toutes les époques de transition, nous regardons virevolter des chauves-souris : voyez mes ailes littéraires... vivent les rats de la rhétorique ! Il n’est pas sûr que celle-ci finisse par gagner, et peut-être roule-t-elle, en définitive, pour la « littérature », en lui permettant d’élargir son corpus tout en lui conservant sa raison d’être. Pour un critique admettant qu’une saine compréhension de la persuasion impose d’en explorer tous les soubassements, combien d’entre nous (moi le premier, avec mes rhétoriqueurs bien-aimés) se bornent à étendre un peu le geste, très IIIe République, de la réhabilitation démocratique (sans trop se soucier de sa réception possible), en conférant le statut de « littérature » à des œuvres que leur nature trop « oratoire » avait jusqu’ici reléguées dans les ténèbres extérieures ? Nous avons vu que le corpus rhétorique ne saurait être digéré en son entier par l’histoire littéraire traditionnelle : il lui ferait éclater l’estomac. Mais nous assistons à un mécanisme de défense par sélection et cooptation, qui « esthétise » certains secteurs ou morceaux du corpus et permet leur assimilation sans trop de douleur au canon existant. De ce point de vue l’histoire de la rhétorique ne ferait que reconduire la vieille idée de l’histoire littéraire concernant « l’humus » des grandes œuvres, en lui donnant les moyens d’une exploration un peu plus systématique d’un contexte de minores – le « système » restant pourtant celui de la littérature, toujours offerte comme telle à l’appréciation des lecteurs d’aujourd’hui.
Une plus saine compréhension de leur « éloquence » a ainsi facilité la redécouverte des tragédies de Garnier ou de Tristan, qui paraissaient, il n’y a pas si longtemps, trop « rhétoriques » : il est juste de dire que le développement d’une certaine compétence oratoire a rendu ces œuvres plus digestes, et plus belles, en tant que littérature. Je revois, dans La Mort de Sénèque mise en scène par Jean-Marie Villégier à la Comédie Française (1984), Richard Fontana en Néron, toussant discrètement dans sa main, avant de faire au Sénèque d’Hubert Gignoux l’un de ces grands discours dont la pièce est cousue. C’était, dans la fiction, une jolie trouvaille : le raclement de gorge du disciple, entre insolence et nervosité, qui s’apprête à montrer ce qu’il sait faire avant de retourner criminellement contre son maître le fruit de ses leçons. Mais j’entends encore le murmure approbateur du public, à qui Fontana, de toute évidence, s’adressait aussi hors de la fiction – et la trouvaille était encore meilleure – pour signaler : « Attention, rhétorique ! », et régler la distance, mi-ironique, mi complice, à laquelle il convenait que nous nous disposions à l’entendre. Un effet « brechtien », chargé de nous ramener au seuil d’un monde où les personnages de théâtre trouvent normal de faire assaut d’éloquence – sans toutefois nous obliger à le franchir. Il me semble que beaucoup d’objets « rhétoriques » négocient de la sorte leur place au soleil du littéraire actuel, en ajoutant à notre conscience esthétique une harmonique oratoire qui ne la bouscule pas. N’en déduisons pas que toutes les récupérations deviennent possibles ; ainsi ne suis-je pas certain que les rhétoriqueurs bénéficient jamais de cette seconde chance auprès d’un vrai public, maintenant qu’ont été « recontextualisées », donc rendues autrement hirsutes, les acrobaties verbales qui leur avaient valu la sympathie intéressée du XXe siècle.
C’est chose faite, en revanche, pour certains auteurs antiques : Cicéron, Sénèque, Lucien, Boèce sont à la mode ; la morale et l’éloquence se donnent à consommer en petits livres dont l’apparence même est calculée pour réduire le caractère intimidant, et signaler à l’amateur le plaisir de bon aloi qu’il ne songeait pas à prendre en des contrées si éloignées de son divertissement. Une collection comme « Le corps éloquent », aux Belles Lettres, qui publie Gorgias, Quintilien ou Amyot sous forme d’essais choisis ou de courts extraits, proclame ainsi sa préférence pour des textes d’une écriture, je cite une 4e de couverture, « qui ne soit ni abstraite, ni technique, ni dogmatique, mais inspirée, dense, pointue, métaphorique, et pour tout dire, poétique ». L’histoire et la théorie de la rhétorique peuvent être lues comme de la poésie ; et Quintilien presque passer pour un essayiste. Autre cas révélateur, celui du pseudo-Longin, dont le Traité du sublime fonctionne, ainsi que l’a montré Francis Goyet (voir son édition de la traduction de Boileau au Livre de Poche, 1995), comme une formation de compromis, une plaque tournante entre poétique et rhétorique, servant à marquer leur différence ou leur proximité, suivant la manière dont nous choisissons de nous rassurer. On pourrait multiplier les exemples, et imaginer à terme, non pas la défaite, mais bien la victoire de l’histoire littéraire, sorte de Grand Louvre ou de Musée d’Orsay (les impressionnistes plus les pompiers) au service d’une littérature élargie par un miracle d’éclectisme. Il s’agit plus que jamais de lire, littéralement et dans tous les sens, comme si l’on pouvait indéfiniment assimiler chaque auteur selon les termes qui sont les siens, puis ranger chaque volume à sa place sur les rayons d’une bibliothèque merveilleuse. Il est temps de reconnaître que beaucoup d’historiens de la rhétorique, loin de vouloir détruire la littérature, entendent la sauver en la rendant plus souple, en ne rédimant que partiellement son anachronisme. L’entreprise a aussi un côté « club des belles lettres » et « plaisir de l’honnête homme » ; c’est même ce contre quoi, me semble-t-il, réagit la théorisation massive, encyclopédique de l’équipe RARE et de quelques autres : rhétorique hard contre rhétorique soft.
Mais ce miraculeux éclectisme n’est probablement (lui aussi) qu’une vue de l’esprit. Lorsque certains auteurs, certaines œuvres sont in, d’autres sont out. Ce ne sont ni les mêmes cercles ni les mêmes moments qui lisent les uns et les autres. Aussi le projet de renflouement du corpus de l’éloquence revêt-il trop souvent – à mes yeux – un aspect « académique » au mauvais sens du terme, occupé avant tout d’enterrer la modernité en effaçant ses ruptures. Comme démarche esthétique, le retour de la rhétorique est si impeccablement postmoderne qu’il n’a pas besoin de s’en défendre, ni même de s’en douter. C’est dire si serait vain, alors, tout espoir de dépasser le stade des morceaux choisis pour sentir revivre en nos consciences une culture « classique » de la persuasion, au-delà des fragments disloqués du grand corps : classicisme et modernisme sont en fait aussi morts l’un que l’autre, et ce qui les remplace, malaise ou éclairs, n’a pas encore de nom. Il reste cependant possible, nouus l’avons vu, de marquer un point de passage entre le dernier cas de figure et le premier, celui qui faisait naître un nouvel « empire » rhétorique sans imitation de l’ancien : si des bribes d’éloquence antique se laissent ainsi « communiquer », c’est par une culture qui tente à nouveau, selon divers biais, de privilégier la formation morale et politique. Sous l’esthétisation des fragments, un tâtonnement – en quête d’un système ressenti comme plus ou moins analogue à celui dont ils sont tirés, et qui se cherche des cautions. La relecture d’un Cicéron ou d’un Plutarque allégés signalerait alors, anachroniquement, la remise en marche d’une éthique pensée à nouveaux frais (ou bricolée à frais réduits) comme le cœur nécessaire de la culture et de la cité.
Dans le même ordre d’idées, on pourrait considérer le Musée d’Orsay (inauguré en 1986) comme une version monumentale et hyperbolique du département de Monterey Bay, où l’on fait apparemment un peu de tout, mais où se mettent sans doute en place de nouvelles structures ou hiérarchies socio-culturelles (la question est de savoir lesquelles). Les pompiers d’Orsay, ainsi rendus à notre attention depuis bientôt vingt ans, procurent d’ailleurs à leur manière une image des ambiguïtés que j’essaie de cerner, et c’est par cette image (certes peu exaltante) que je terminerai. Car on peut justifier leur présence par l’histoire, par le souci d’exactitude et d’exhaustivité historiques : un musée consacré à l’art de la seconde moitié du XIXe siècle se doit de (re-)présenter toute la production de la période considérée ; c’est l’inventaire, le « récit » de la vérité dans sa complexité (à quoi font obstacle les sélections du goût) qui est intéressant. On peut aussi justifier leur présence (au contraire ou en même temps) par l’amour de l’art, et même de l’art pour l’art, mais sur l’air postmoderne des goûts et des couleurs : aimer Manet n’interdit plus d’aimer Couture – et l’amour de Couture se voudra, indifféremment, conservateur ou pro vocateur. On peut, enfin, reconnaître en eux le contour affaibli, le profil dégradé, donc perversement émouvant de valeurs qui nous attirent à nouveau, mais que nous ne savons trop comment faire « renaître », ni (surtout) pourquoi. Nous n’avons pas vraiment cessé de juger faisandée la vision d’un William Bouguereau, par exemple ; mais le simple fait que nous puissions tolérer d’en contempler les produits (au moins depuis l’exposition du Petit Palais, qui date, comme le Sénèque de Villégier, de 1984) témoigne – au-delà de l’éclectisme – d’un regain d’intérêt pour une forme de « rhétorique », c’est-à-dire pour un art discursif, adressé plutôt que solitaire, émanant d’une « institution » plutôt que de la « terreur » irrémédiable de l’artiste. En cette année 1867 – où l’on s’enorgueillit, depuis déjà pas mal de temps, d’ignorer leurs directives – les Muses de Bouguereau ont l’air morose, vaguement agressif, et aussi peu inspiré que possible. En sens inverse, et en vertu même de leur kitsch classicisant, il me semble qu’elles peuvent servir d’emblème provisoire (relais ironique, avertissement amer, morne défi, c’est selon) à nos lentes et confuses tentatives de renouer, que nous le voulions ou non, avec un « âge de l’éloquence ».
vocateur. On peut, enfin, reconnaître en eux le contour affaibli, le profil dégradé, donc perversement émouvant de valeurs qui nous attirent à nouveau, mais que nous ne savons trop comment faire « renaître », ni (surtout) pourquoi. Nous n’avons pas vraiment cessé de juger faisandée la vision d’un William Bouguereau, par exemple ; mais le simple fait que nous puissions tolérer d’en contempler les produits (au moins depuis l’exposition du Petit Palais, qui date, comme le Sénèque de Villégier, de 1984) témoigne – au-delà de l’éclectisme – d’un regain d’intérêt pour une forme de « rhétorique », c’est-à-dire pour un art discursif, adressé plutôt que solitaire, émanant d’une « institution » plutôt que de la « terreur » irrémédiable de l’artiste. En cette année 1867 – où l’on s’enorgueillit, depuis déjà pas mal de temps, d’ignorer leurs directives – les Muses de Bouguereau ont l’air morose, vaguement agressif, et aussi peu inspiré que possible. En sens inverse, et en vertu même de leur kitsch classicisant, il me semble qu’elles peuvent servir d’emblème provisoire (relais ironique, avertissement amer, morne défi, c’est selon) à nos lentes et confuses tentatives de renouer, que nous le voulions ou non, avec un « âge de l’éloquence ».
[1] Traduction (infidèle, faute de pouvoir préciser le sexe des professeurs mentionnés) : « Lors de la création d’une nouvelle branche de California State University à Monterey Bay, il y a huit ans, les fondateurs avaient reçu pour consigne d’établir un ensemble de départements définis de manière non conventionnelle. Un petit groupe de professeurs d’Humanités se réunirent pour former un programme intégré dont la mission serait de préparer les étudiants à tenir, par la pensée et par l’action, un rôle éthique, créatif et critique dans une société culturellement diverse et un monde toujours plus interconnecté. Le groupe fut laissé maître de se développer comme il l’entendait, sans tenir compte des disciplines établies. Aujourd’hui ce département rassemble des compétences qui portent respectivement sur la philosophie, le droit et la communication ; l’histoire culturelle des États-Unis ; le journalisme et les médias ; l’histoire orale au sein des Latina-Latino studies (l’intéressé(e) vient de la littérature espagnole médiévale) ; la rhétorique, les études religieuses et les études de genre. Le département compte encore une figure du mouvement qui croise ateliers d’écriture et action sociale, une poète chicana reconnue dont l’expérience couvre aussi le droit et les affaires, et une demi-douzaine d’autres enseignants engagés dans le même genre de transdisciplinarité. »